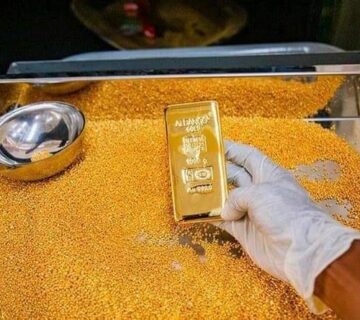Un an après le début de l’exploitation du pétrole à Sangomar : le Sénégal dépasse les attentes et affirme sa souveraineté énergétique
Il y a un an, le 11 juin 2024, la société australienne Woodside Energy lançait officiellement l’exploitation pétrolière du champ offshore de Sangomar, marquant une étape décisive pour le secteur énergétique sénégalais. Grâce à son unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), installée au large des côtes, les premiers barils de brut étaient extraits des profondeurs de l’Atlantique.
Douze mois plus tard, le bilan dépasse largement les projections initiales. D’après un rapport du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, relayé par l’Agence de presse sénégalaise (APS), la production nationale a atteint 16,9 millions de barils en 2024, soit bien au-dessus des 11,7 millions prévus. Cette performance exceptionnelle s’est traduite par des recettes avoisinant les 950 millions de dollars (soit 595,5 milliards de francs CFA), illustrant l’importance économique de cette ressource pour le pays.
Le champ de Sangomar, situé à environ 100 kilomètres des côtes sénégalaises, repose sur un réseau de 12 puits en activité, connectés à la plateforme FPSO. Celle-ci assure une production stable de près de 100 000 barils par jour, destinés en grande partie aux marchés internationaux. Une nouveauté de taille a également marqué cette première année : le marché intérieur a pu bénéficier, pour la première fois, d’un approvisionnement en brut extrait localement. Ce tournant est salué par les autorités comme un pas important vers une plus grande autonomie énergétique.
La dynamique s’est poursuivie au cours des premiers mois de 2025. En janvier, la production s’est élevée à 3,11 millions de barils, avant de se stabiliser à 2,70 millions en février, puis de repartir à la hausse avec 3,08 millions en mars et un record de 3,8 millions en avril, correspondant à quatre cargaisons destinées à l’export. Si cette tendance se confirme, le Sénégal pourrait franchir le cap des 30,5 millions de barils produits d’ici la fin de l’année, soit près du double du volume de 2024.
Au-delà des chiffres, ce premier anniversaire symbolise un tournant historique pour le pays. Le gouvernement souligne l’importance d’une gestion rigoureuse et transparente de cette manne pétrolière, affirmant sa volonté d’en faire un moteur de développement durable et de prospérité partagée pour l’ensemble de la population.

 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad