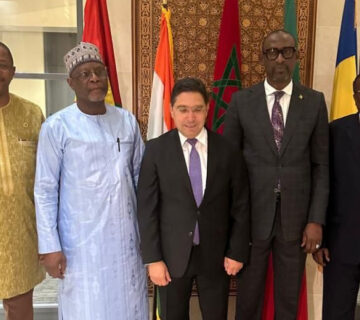La création de l’Alliance des États du Sahel (AES) par le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2023 a profondément bouleversé l’équilibre régional en Afrique de l’Ouest. Ce bloc, né d’une rupture avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), soulève une question cruciale : ces deux entités peuvent-elles réellement coexister et collaborer dans un contexte géopolitique tendu ?
AES et Cédéao : Deux visions opposées de l’intégration régionale ?
La Cédéao, fondée en 1975, a pour mission principale l’intégration économique, politique et sociale des 15 États membres de la région. Elle repose sur des principes de libre circulation, d’union économique et de gouvernance démocratique, avec une intervention croissante dans les crises politiques et sécuritaires.
À l’inverse, l’AES, lancée en septembre 2023, repose sur un socle fondamentalement différent :
Priorité à la souveraineté nationale et au rejet des ingérences étrangères.
Approche militaro-sécuritaire, en réponse aux insurrections djihadistes qui frappent ces trois pays.
Remise en cause des sanctions de la Cédéao, perçues comme punitives après les coups d’État militaires au Mali (2021), au Burkina Faso (2022) et au Niger (2023).
Ces différences idéologiques et stratégiques ont conduit ces pays à quitter officiellement la Cédéao en janvier 2024, affirmant vouloir tracer leur propre voie dans la gestion des défis régionaux.
Des intérêts communs en matière de sécurité et d’économie
Malgré leurs divergences, la Cédéao et l’AES partagent des défis communs, notamment en matière de sécurité et de développement économique.
La lutte contre le terrorisme
Les trois pays de l’AES font face à une menace djihadiste persistante, qui menace également des États membres de la Cédéao comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire. Une coopération renforcée en matière de renseignement et d’opérations militaires serait bénéfique pour toute la région.
Le commerce et la libre circulation
L’interdépendance économique entre les pays de l’AES et le reste de la Cédéao est une réalité incontournable. L’application stricte des sanctions économiques a montré l’impact négatif d’un cloisonnement régional, notamment sur le commerce des produits agricoles et énergétiques.
Vers une reconnaissance mutuelle et une coopération pragmatique ?
L’issue des tensions entre les deux organisations pourrait prendre plusieurs formes :
Scénario 1 : Une reconnaissance officielle de l’AES par la Cédéao
Si la Cédéao adopte une posture plus conciliante, une reconnaissance mutuelle pourrait permettre une coopération sur des dossiers stratégiques, notamment la sécurité et l’économie. Cela nécessiterait des réformes diplomatiques pour garantir des relations stables entre les deux blocs.
Scénario 2 : Une concurrence régionale et une fragmentation de l’Afrique de l’Ouest
Si les tensions persistent, l’AES pourrait chercher à étendre son influence en intégrant d’autres pays partageant sa vision souverainiste, tandis que la Cédéao tenterait de se renforcer sans ses anciens membres. Un tel schisme affaiblirait la capacité de l’Afrique de l’Ouest à relever les défis communs.
Scénario 3 : Une coopération pragmatique sans reconnaissance formelle
Même sans reconnaissance officielle, la nécessité d’une coordination sur des sujets comme la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux économiques pourrait aboutir à une collaboration indirecte sur certains dossiers stratégiques.
Coexister ou s’affronter ?
La coexistence de la Cédéao et de l’AES est possible, mais conditionnée par un dialogue structuré et une volonté mutuelle d’éviter la confrontation.
Tant que les deux entités ne parviendront pas à harmoniser leurs intérêts, la région restera exposée à une instabilité accrue, freinant le développement et la lutte contre les menaces sécuritaires.
L’avenir de l’Afrique de l’Ouest dépendra donc de la capacité des dirigeants à privilégier une approche pragmatique, dépassant les divergences politiques au profit de la stabilité et du progrès régional.


 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad