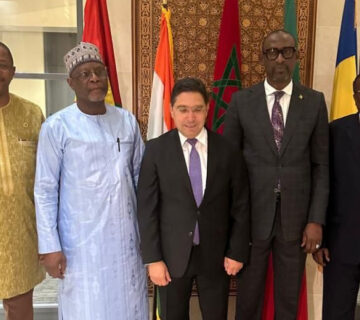Lutte contre la fistule obstétricale au Niger : lancement d’un camp de chirurgie pour les cas complexes
Dans le cadre de la lutte contre la fistule génitale féminine, les autorités sanitaires nigériennes, en collaboration avec leurs partenaires, ont procédé au lancement officiel d’un camp de chirurgie dédié aux cas complexes de fistule obstétricale. Cette initiative, organisée à l’hôpital national de Niamey, s’inscrit dans une dynamique de renforcement des soins spécialisés à destination des femmes vivant avec cette pathologie invalidante.
Le camp chirurgical, qui s’étendra sur plusieurs jours, mobilise une équipe multidisciplinaire de chirurgiens nationaux et internationaux expérimentés dans la prise en charge des fistules complexes. Il vise à offrir des interventions chirurgicales gratuites, améliorer la qualité des soins apportés aux patientes, mais aussi renforcer les compétences techniques du personnel de santé local.
Lors de la cérémonie de lancement, la ministre déléguée chargée de la Santé de la Reproduction a salué l’engagement des acteurs impliqués dans cette opération. « Ce camp de chirurgie est une réponse humanitaire et médicale à un drame silencieux qui détruit la vie de milliers de femmes. En redonnant leur dignité à ces femmes, nous consolidons notre engagement pour une société plus juste et plus équitable », a-t-elle affirmé.
Cette opération bénéficie du soutien technique et financier de partenaires tels que l’UNFPA, l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), ainsi que des ONG spécialisées dans la santé reproductive. En plus des interventions chirurgicales, le programme prévoit un accompagnement psychosocial, une assistance à la réinsertion économique et des campagnes de sensibilisation communautaire.
Le lancement de ce camp chirurgical s’inscrit dans le Plan national de lutte contre la fistule au Niger, avec pour objectif l’élimination de cette pathologie d’ici 2030, conformément aux engagements internationaux pris par le pays.

 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad