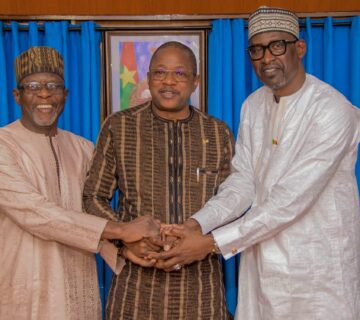Pénurie d’essence au Niger : Une crise énergétique aux multiples enjeux
Depuis plusieurs semaines, le Niger fait face à une pénurie d’essence sans précédent, perturbant l’économie et le quotidien des populations. Cette situation a entraîné des files d’attente interminables dans les stations-service, avec de nombreuses stations totalement à sec, notamment dans la capitale Niamey.
Les causes de la pénurie
La crise actuelle trouve son origine dans plusieurs facteurs structurels et conjoncturels :
- La diminution du marché noir Historiquement, une part importante de l’essence consommée au Niger provenait du marché noir, alimenté en grande partie par la contrebande en provenance du Nigeria. Cependant, la suppression des subventions sur les carburants au Nigeria en 2023 a entraîné une hausse des prix, rendant cette activité moins lucrative et réduisant ainsi l’offre clandestine d’essence sur le marché nigérien.
- Une production nationale insuffisante La Société de Raffinage de Zinder (SORAZ), principale source de production d’essence du pays, ne parvient pas à répondre à la demande. Actuellement, elle ne fournit qu’environ 25 citernes par jour, alors que les besoins quotidiens du pays sont estimés entre 40 et 50 citernes.
- Les difficultés logistiques d’approvisionnement Face au déficit de production locale, la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) a mis en place un plan d’importation de carburant. Des stocks importants sont disponibles à Lomé, au Togo, mais leur acheminement reste complexe. Les camions doivent traverser des zones instables, nécessitant des escortes militaires pour garantir la sécurité du transport.
Conséquences économiques et sociales
La pénurie d’essence a des répercussions significatives sur plusieurs secteurs :
- Impact sur les transports : Les prix du transport ont fortement augmenté, affectant les travailleurs et les petites entreprises dépendantes de la mobilité.
- Ralentissement des activités économiques : De nombreuses entreprises, notamment celles utilisant des groupes électrogènes, subissent des perturbations dans leur production.
- Inflation : La hausse du coût du transport se répercute sur le prix des marchandises, augmentant le coût de la vie pour la population.
Solutions et perspectives
Pour remédier à cette crise, plusieurs mesures sont en cours d’étude :
- Augmentation de la production locale : Un renforcement des capacités de la SORAZ pourrait permettre de réduire la dépendance aux importations.
- Diversification des sources d’approvisionnement : Accélérer et sécuriser l’importation depuis d’autres pays voisins.
- Renforcement de la logistique de distribution : Optimiser la gestion des stocks et le transport pour assurer un approvisionnement plus régulier.
La pénurie actuelle met en lumière les défis structurels du secteur énergétique nigérien. Il est crucial pour le pays de développer une stratégie durable visant à assurer son autosuffisance énergétique et à stabiliser le marché du carburant.

 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad