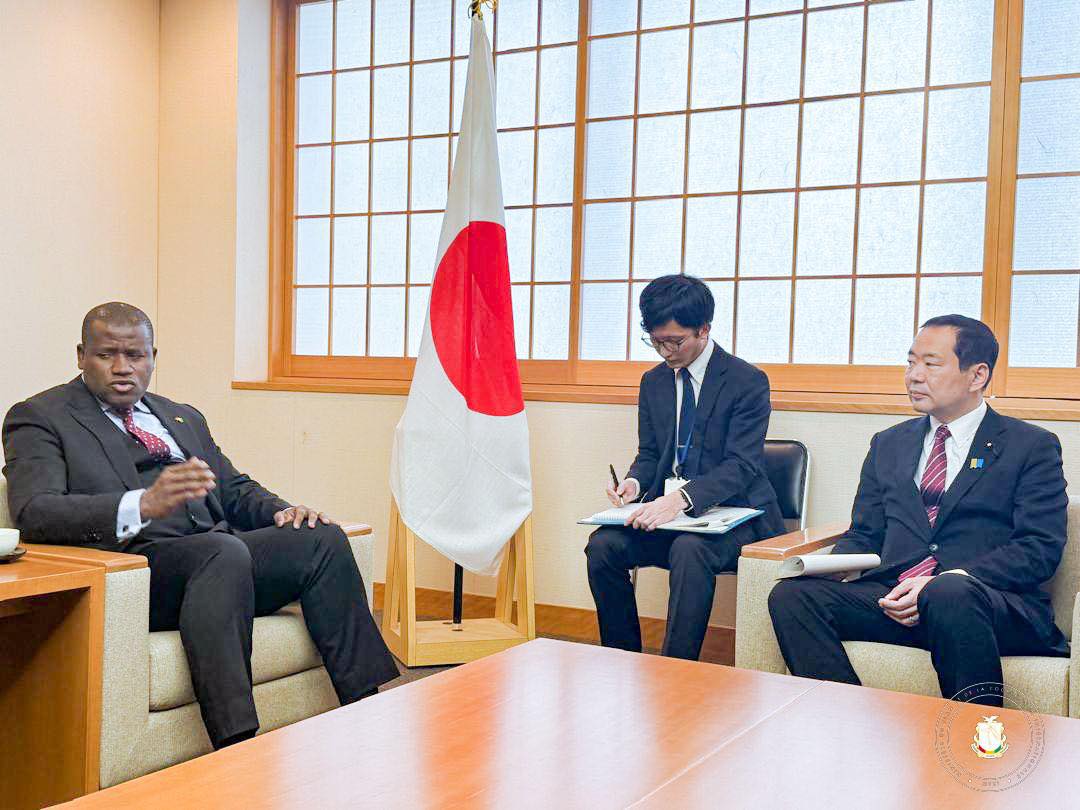Sénégal : Lancement de la Phase 2 du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable pour 2 Millions de Personnes
Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé, ce matin à Fass Touré, dans le département de Kébémer, la deuxième phase du Projet d’approvisionnement en eau potable. Cette initiative vise à améliorer durablement l’accès à l’eau potable pour plus de deux millions de Sénégalais vivant en milieu rural.
Un engagement pour l’équité et la transparence
Lors de son discours, le Premier ministre a mis en avant l’importance d’une gestion optimisée et transparente des investissements publics. Il a rappelé que ce projet s’inscrit dans une politique nationale visant à réduire les disparités entre zones urbaines et rurales en matière d’accès à l’eau.
« Notre ambition est de garantir que chaque citoyen, où qu’il se trouve, puisse bénéficier d’un accès équitable à l’eau potable. Ce projet reflète notre engagement à assurer une distribution plus juste et efficace des ressources », a déclaré Ousmane Sonko.
Un projet structurant pour le développement durable
Alignée sur l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050, cette phase du projet répond à un impératif de justice sociale et de développement durable. L’accès sécurisé à l’eau, reconnu comme un droit fondamental par les Nations Unies, est une priorité absolue pour le gouvernement.
Avec un budget de 64 milliards FCFA, cette seconde phase prévoit la construction de 85 forages, 89 châteaux d’eau et l’installation de 5250 compteurs. De plus, un réseau de 1450 km de conduites et plus de 18 000 branchements particuliers seront déployés dans toutes les régions du pays, à l’exception de Dakar.
Un impact significatif sur les populations
Grâce à ces infrastructures, plus de 2 millions de personnes bénéficieront directement d’un accès amélioré à l’eau potable. Ce projet marque ainsi une avancée cruciale dans la lutte contre les inégalités et contribue à une amélioration significative des conditions de vie en milieu rural.
Le gouvernement entend poursuivre ces efforts pour faire de l’accès à l’eau une réalité pour tous, renforçant ainsi la résilience des populations face aux défis environnementaux et sanitaires.

 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad