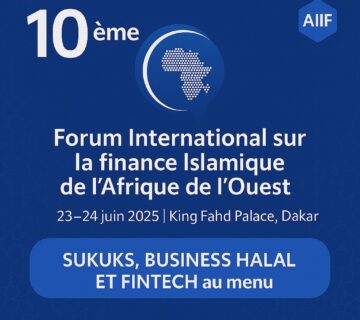Dans son discours d’ouverture, le président Diomaye Faye a rappelé la promesse d’un renouveau démocratique profond, formulée durant sa campagne présidentielle. Il a appelé à des échanges francs, inclusifs et tournés vers l’intérêt général, déclarant :
“Ce dialogue n’est pas une formalité politique, c’est un contrat de refondation. Il engage chacun de nous à penser un État plus juste, plus souverain, plus participatif.”
Les axes abordés incluent :
-
La réforme des institutions (équilibre des pouvoirs, renforcement du Parlement, du Conseil constitutionnel, etc.) ;
-
Le système électoral et le financement des partis ;
-
La transparence et la lutte contre l’impunité ;
-
La gouvernance territoriale et les droits citoyens ;
-
Le rôle de l’armée, de la justice et des médias dans la construction démocratique.
Une large participation… mais quelques absents notables
La salle du CICAD a réuni :
-
Des représentants de partis politiques (notamment du camp présidentiel et de l’opposition modérée),
-
Des acteurs de la société civile,
-
Des chefs religieux et coutumiers,
-
Des organisations syndicales, patronales et de jeunesse,
-
Des universitaires et intellectuels.
Cependant, des voix critiques se sont fait entendre en amont. Le Parti démocratique sénégalais (PDS) et l’APR (ex-parti au pouvoir) ont décliné l’invitation, évoquant des “zones d’ombre” dans l’organisation et des “intentions unilatérales” dans les conclusions à venir.
Une méthode consultative et itérative
Le gouvernement a assuré que le dialogue se tiendra jusqu’au 4 juin, selon un format participatif et thématique, avec des commissions sectorielles, des restitutions quotidiennes et un rapport final public.
Un comité d’observation, incluant des représentants religieux, des juristes indépendants et des observateurs internationaux, est chargé de veiller à la régularité et à la neutralité des débats.
Enjeux : restaurer la confiance et poser les fondations de la “troisième République”
Pour de nombreux analystes, ce Dialogue national est une fenêtre d’opportunité historique pour :
-
Sortir des logiques de confrontations héritées des régimes précédents,
-
Restaurer la confiance entre l’État et les citoyens,
-
Moderniser des institutions souvent jugées obsolètes ou manipulables,
-
Réaffirmer la souveraineté populaire dans les choix de société.
Mais la réussite du dialogue dépendra de la sincérité du processus, de la traduction des conclusions en actes concrets, et de la capacité à inclure les forces réfractaires sans exclusion ni récupération politique.
Un moment fondateur ou un simple symbole ?
Le Dialogue national est lancé. Reste à voir s’il sera le socle d’une “troisième République sénégalaise” plus équitable, plus inclusive et plus souveraine… ou s’il se limitera à une tentative de consensus politique sans lendemain.
Le peuple sénégalais, attentif et exigeant, observe.


 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad