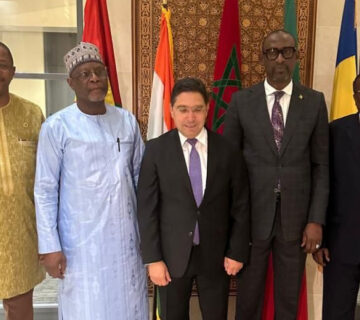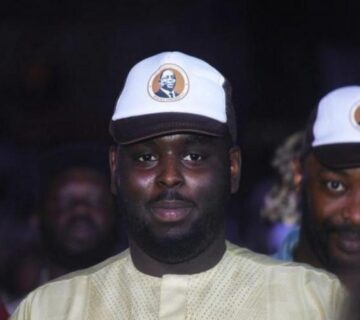Guinée : Une stratégie minière ambitieuse pour un développement durable
Dans un contexte de transition économique et de quête d’une souveraineté industrielle accrue, la République de Guinée affine une stratégie minière ambitieuse, structurée autour de quatre piliers majeurs : la transformation locale des ressources, la création de valeur durable, le renforcement des infrastructures, et l’inclusion socio-économique.
Cette orientation stratégique a été consolidée à l’issue d’un atelier de concertation organisé par le ministère des Mines et de la Géologie, en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la GIZ et la Chambre des mines de Guinée.
Transformation locale : priorité au contenu national
Consciente de la nécessité de capter davantage de valeur ajoutée sur son territoire, la Guinée a lancé plusieurs chantiers majeurs, dont :
-
Le démarrage officiel des travaux de la raffinerie d’alumine à Kimbo (mars 2025),
-
L’instauration d’un cadre incitatif pour la transformation in situ de la bauxite, du fer et de l’or.
Ces initiatives visent à développer un écosystème industriel minier intégré, créateur d’emplois et porteur de transferts de compétences.
Vers la création d’un fonds souverain minier
Dans le cadre du programme Simandou 2040, les autorités prévoient la mise en place d’un fonds souverain national, destiné à :
-
Gérer les recettes minières de manière transparente,
-
Financer des projets d’intérêt public (infrastructures, éducation, santé),
-
Préparer l’après-mines en diversifiant l’économie guinéenne.
Ce fonds répond à un impératif : convertir la rente minière en actifs pérennes pour les générations futures.
Infrastructures structurantes : levier de compétitivité
Le projet Simandou comprend également la réalisation d’infrastructures majeures :
-
Une voie ferrée de plus de 600 km reliant les zones minières à la côte,
-
Un port en eau profonde à Morébaya pour faciliter les exportations et l’intégration logistique régionale.
Ces investissements visent à réduire les coûts d’évacuation des minerais, tout en renforçant l’attractivité du pays auprès des opérateurs internationaux.
Capital humain : montée en compétence locale
Le gouvernement, avec le soutien de ses partenaires, a engagé la création de l’École de Formation aux Métiers de l’Alumine de Guinée (EFAG) à Boké.
Cette école formera une nouvelle génération de techniciens et d’ingénieurs spécialisés, avec pour objectif de réduire la dépendance à l’expertise étrangère et de structurer une main-d’œuvre compétente dans la chaîne de valeur minière.
Une approche inclusive et durable
La nouvelle stratégie minière guinéenne s’inscrit résolument dans une logique de durabilité, d’équité et de concertation. Elle inclut :
-
La prise en compte des préoccupations environnementales et sociales,
-
L’implication des communautés locales dans la gouvernance des projets,
-
Le renforcement du lien entre mines, agriculture, et agrobusiness pour une économie plus diversifiée.
Avec cette feuille de route ambitieuse, la Guinée affirme sa volonté de passer d’une économie extractive à une économie productive et résiliente.
La stratégie actuelle reflète une vision claire : faire des ressources minières un moteur de transformation structurelle, au service du développement national, de l’inclusion sociale et de la souveraineté économique.

 Burkina Faso
Burkina Faso Cameroun
Cameroun Gambie
Gambie Guinée
Guinée Mali
Mali Mauritanie
Mauritanie Niger
Niger Nigéria
Nigéria Sénégal
Sénégal Tchad
Tchad